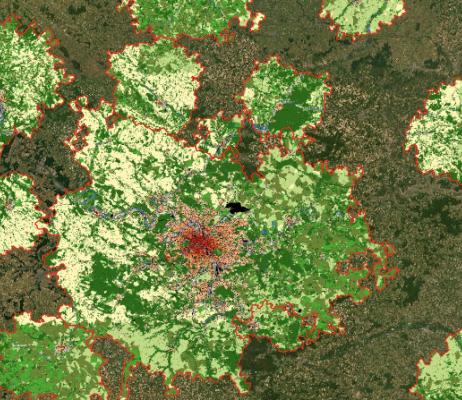La RSE s’est imposée comme le cadre incontournable pour réduire les impacts sociaux et environnementaux des entreprises. Mais un nouveau modèle gagne du terrain : l’économie régénérative, qui ambitionne de restaurer les écosystèmes et de créer une valeur positive nette et non pas uniquement carbone neutre. Faut-il les opposer, les combiner ou imaginer une évolution naturelle de l’un vers l’autre ?
Par Gaël Clouzard
ODD N°13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
La RSE, aujourd’hui généralisée, est née d’une nécessité : encadrer et réduire les externalités négatives des entreprises. Elle a permis d’introduire des standards devenus familiers — bilans carbone, normes ISO, politiques de diversité, chartes éthiques. En deux décennies, elle s’est imposée comme un socle commun et un outil de pilotage. Mais son horizon reste souvent défensif : limiter la casse, corriger à la marge, rassurer investisseurs et consommateurs.
L’économie régénérative change de perspective. Elle ne cherche pas seulement à réduire les impacts, mais à améliorer les systèmes dont dépend l’activité économique : biodiversité, climat, cycles de l’eau, santé des sols, qualité de vie des communautés. Son ambition est de créer une valeur positive nette, en s’appuyant sur une vision systémique. Produits réparables ou bio-assimilables, modèles d’usage plutôt que de possession, coopération avec les territoires pour restaurer des écosystèmes : les leviers sont multiples. Et c’est ce que stipule la revue académique anglaise Science Direct dans son article : Towards regenerative business models: A necessary shift? : “ Les organisations avec des modèles d’affaires régénératifs se concentrent sur la santé planétaire et le bien-être sociétal. Ce positionnement va au-delà de simplement atténuer les impacts négatifs : c’est un déplacement vers la notion d’impact « positif net “
Une rupture ou une continuité ?
Dans les faits, les deux approches coexistent. La RSE apporte des cadres et des indicateurs fiables, indispensables pour crédibiliser les engagements. L’économie régénérative fixe un cap plus exigeant et oblige à repenser les modèles d’affaires. Pour beaucoup d’entreprises, la RSE constitue une première marche, avant d’ouvrir la voie à des démarches régénératives. “C’est là où doit aller toute entreprise. L’économie régénérative est le modèle dans lequel on doit s’inscrire, la raison d’être est la mission de l’entreprise dans ce qu’elle veut apporter à la société. Sachant que si quelques-unes ont déjà une trajectoire et sont en phase d’adaptation, beaucoup en sont au stade du renoncement, c’est-à-dire d’abandonner un segment ou un business model, tandis que d’autres en sont encore au retournement, c’est-à-dire qu’elles doivent trouver comment faire différemment.” confiait dans nos colonnes Eric Duverger le fondateur de la CEC* qui était focalisée sur l’économie rénégérative
En France, plusieurs initiatives illustrent déjà ce glissement. Tikamoon, fabricant de mobilier, travaille sur des matériaux et des designs circulaires. Terideal a inscrit une intention régénérative dans sa raison d’être, en associant ses parties prenantes. Open Lande mène des projets de renaturation et de restauration des sols dans différents territoires. Ces expériences montrent que l’économie régénérative n’est pas une théorie hors sol mais une trajectoire opérationnelle.
La bascule vers ce nouveau modèle reste progressive. Elle suppose d’élargir les indicateurs au-delà du carbone, de transformer les offres vers la circularité et l’usage, de renforcer les coopérations locales et de replacer l’humain au centre. Elle implique aussi des investissements et une évolution culturelle, mais ouvre des perspectives de résilience et d’innovation.
Au final, la RSE n’est pas condamnée à disparaître. Elle fournit une base solide. Mais la pression écologique et sociale pousse de plus en plus d’acteurs à élargir le cadre. L’économie régénérative devient alors une boussole, non pour remplacer la RSE, mais pour l’amener plus loin.